Opt‑out fantôme - Quand refuser les IA de Meta relève de l’impossible
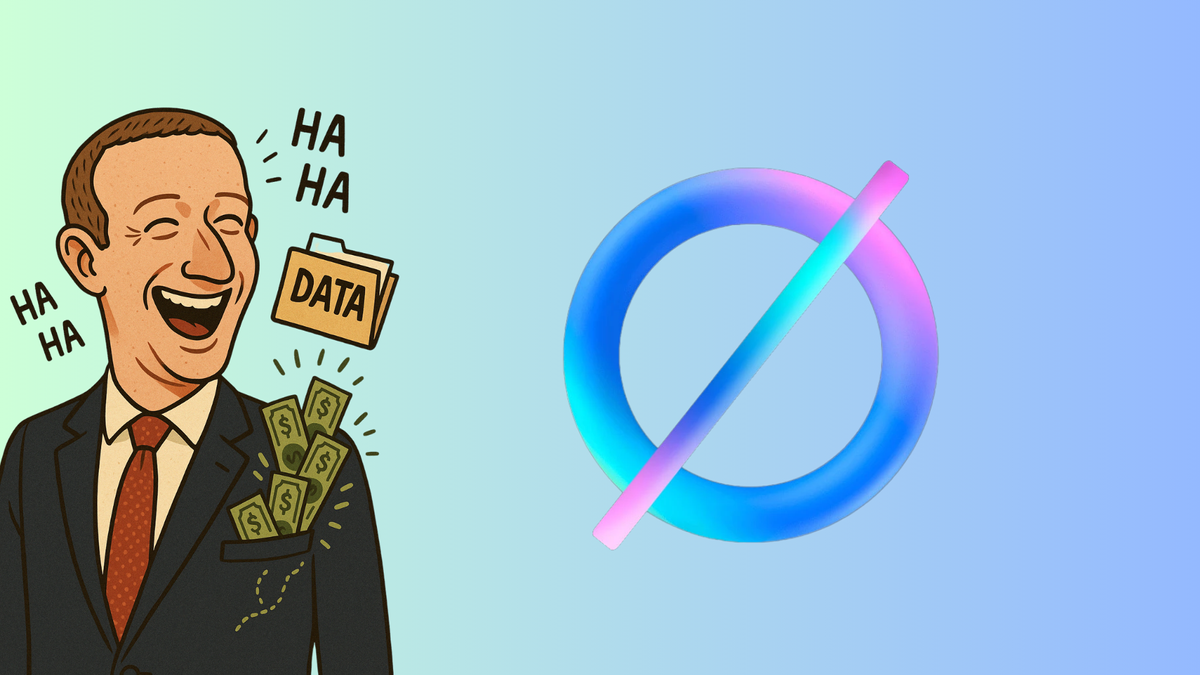
Depuis toujours, Meta nous bassine avec ses promesses de transparence et de respect de la vie privée. Aujourd’hui, la réalité est autrement plus cynique. La firme tente en catimini d’extraire nos photos, nos publications et nos conversations pour nourrir ses modèles d’intelligence artificielle, sans le moindre contrepartie pour les utilisateurs. Pire encore, quand certains d’entre nous essaient de refuser cette appropriation indue, les outils officiels se révèlent purement et simplement inopérants.
Nate Hake, éditeur et fondateur de Travel Lemming, est l’un des premiers à tirer la sonnette d’alarme. Il a reçu un courriel de Meta l’informant que son contenu Instagram et Facebook servirait bientôt à entraîner les algorithmes maison. On lui indiquait également qu’il avait la possibilité de s’opposer à ce prélèvement massif de données, grâce à un formulaire en ligne. Sauf que ce lien est un leurre, la page ne s’affiche jamais, et l’utilisateur reste captif d’une démarche d’opt‑out qu’on lui vend comme simple et rapide, mais qui s’avère totalement désactivée.
I tried to opt out. They would not let me. They said they go by state laws. No laws exist to prevent this….. on a positive note, have you seen this recent Meta Whistleblowers testimony? Meta sold out America to China. https://t.co/hNbsg1e7oG
— Take Back Our Art (@takebackourart) April 19, 2025
On pourrait croire à un simple bug technique. Pourtant, une telle explication serait trop flatteuse pour le géant américain, qui clame haut et fort son engagement à respecter les choix de ses membres. Quand Hake a tenté de relancer le service client, la réponse est tombée comme un couperet:
« Nous ne pouvons pas donner suite à votre demande. »
La société assure pourtant que toutes les objections déjà enregistrées seront honorées. Autrement dit, un vœu pieux pour une entreprise qui se targue d’une politique irréprochable. Le paradoxe n’est pas nouveau. Dès 2018, à l’époque où la maison mère s’appelait encore Facebook, elle reconnaissait utiliser les millions d’images partagées sur Instagram pour former ses premiers algorithmes. À cette époque, Meta AI et les modèles Llama n’existaient pas, mais le signal était déjà donné: l'entreprise n’a jamais eu peur de tremper les mains dans les contenus de ses utilisateurs. Aujourd’hui, alors qu'elle met tous ses œufs dans le panier de l’IA, l’appétit pour de nouvelles données n’a fait que croître, jusqu’à gommer toute notion de consentement effectif.
Les Européens pensaient bénéficier d’une protection renforcée grâce au RGPD et aux décisions des autorités de régulation. En juin dernier, Meta annonçait pourtant la suspension de ses projets de formation d’IA sur les données issues de l’Union Européenne, invoquant la complexité du cadre légal. Cette pause a été de courte durée. Moins d’un an plus tard, la société informe qu’elle va à nouveau puiser dans les photos, les vidéos, les commentaires et même les conversations avec Meta AI, pour ses utilisateurs basés en Europe et au Royaume‑Uni. Elle tente alors de justifier cette remise en route par un argument fallacieux:
« Nous nous alignons sur Google et OpenAI, qui exploitent déjà les données européennes pour leurs modèles. »
Sous couvert d’uniformisation, elle banalise l’intrusion dans nos vies privées. Mais l’adoption par d’autres ne légitime en rien le recours à des pratiques douteuses. Le plagiat digital n’est pas moins condamnable quand il devient une norme de l’industrie.

Au cœur de ce dossier se trouve l’outil d’objection, un formulaire promettant un retrait immédiat de toute participation à l’entraînement de l’IA. Or, il existe bel et bien, mais invisible, inopérationnel, comme une fausse option destinée à apaiser les critiques. Ceux qui cliquent dessus se heurtent à un mur et voient leur demande purement et simplement ignorée. À en croire Meta, tout fonctionne parfaitement, même quand le lien mène nulle part. Cette situation traduit un profond mépris pour l’utilisateur. Plutôt que de mettre en œuvre une plateforme fiable permettant d’exercer un véritable droit de retrait, l'entreprise préfère jouer sur l’inertie et la lassitude. Qui prendra le temps de relancer indéfiniment un service client pour qu’un formulaire fonctionne enfin ? Au lieu de tirer les leçons de ses erreurs passées, Meta accumule les reniements. Son discours de transparence vire au parcours semé d’embûches.
Que faire face à cette mécanique opaque ? La vigilance s’impose. Continuer à nourrir un monstre insatiable, c’est participer à l’abandon progressif de tout contrôle sur nos données. Les régulateurs européens devront sans doute brandir la menace de sanctions pour contraindre la société de Mark Zuckerberg à mettre en place un dispositif de désinscription réellement opérationnel. En attendant, ne restez pas passifs, signalez toute difficulté d’opt‑out aux autorités de protection des données, pressez vos députés et, surtout, diffusez l’information autour de vous.
Meta se présente comme le champion de l’innovation et de la connectivité mondiale. Dans les faits, la firme use d’artifices pour transformer chaque photo de vacances, chaque statut personnel et chaque échange privé en carburant pour ses machines. À l’heure où l’IA occupe une place centrale dans les stratégies de croissance, la question du consentement ne doit pas être reléguée au second plan. Nous ne sommes pas des matières premières à exploiter. Il est temps d’exiger un vrai respect de notre volonté. Si l’entreprise tient à son image d’acteur responsable, elle doit prouver sur le terrain qu’elle respecte nos choix. Un lien vaudra mille discours. Redonnez-nous la maîtrise de nos données ou préparez‑vous à une avalanche de recours juridiques et d’actions collectives. La généreuse promesse de la gratuité de vos comptes ne saurait justifier la privation de votre souveraineté numérique.




