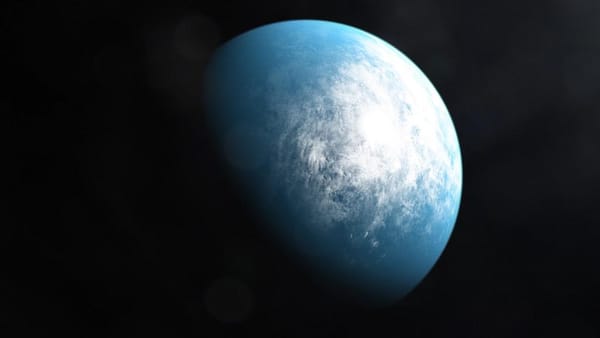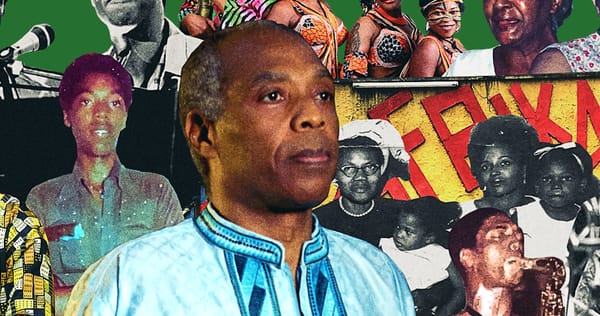Nike face à la justice - La chute du projet NFT RTFKT et le désenchantement des investisseurs

La semaine dernière, un groupe d’acheteurs de NFT a décidé qu’il en avait assez. Las de voir leurs investissements s’évaporer comme une bulle de savon, ces derniers ont assigné Nike en justice pour avoir mis brutalement fin à son projet virtuel RTFKT. Derrière l’affaire se cache une histoire édifiante, celle d’une entreprise mondialisée qui, grisée par l’appât du gain instantané et l’illusion de la modernité, a sacrifié la confiance de ses propres clients. Tout débute en décembre 2021. la marque de sport, toujours avide de capitaliser sur les dernières tendances, fait l’acquisition de RTFKT, une jeune pousse spécialisée dans les objets de collection numériques, les fameux NFT. Le discours officiel promet l’innovation de pointe pour offrir la prochaine génération de collectibles mêlant culture et gaming. Dans la vraie vie, cela signifie des images high-tech de baskets virtuelles, vendues à prix d’or sur la blockchain, un registre infalsifiable vanté comme indestructible.

Mais très vite, la supercherie montre ses limites. Comme tant d’autres géants du luxe ou de la tech avant elle, la société Nike sous-estime la complexité de l’univers crypto et surestime l’appétit pour des actifs dont la valeur ne repose sur rien de tangible. Après quelques mois d’engouement médiatique et de spéculation effrénée, le soufflé retombe. Les portefeuilles numériques se vident, la communauté râle et les investisseurs, quant à eux, comprennent qu’ils ont misé sur un château de cartes. C’est en décembre 2024 que Nike actionne le couperet. Sans crier gare, la marque annonce, via le compte officiel de RTFKT sur X, qu’elle arrête toute activité liée au projet d’ici la fin janvier 2025. Ni explications claires, ni plan de transition, juste une mise à mort expéditive destinée à limiter les dégâts… pour elle. Résultat ? Un effet domino, la demande pour les NFT CloneX s’effondre, les prix chutent, et, pour beaucoup, l’investissement se mue en perte sèche.

Rongés par la colère et la désillusion, Jagdeep Cheema, résident australien et porte-voix des plaignants, mène la fronde. Dans un recours collectif déposé à Brooklyn, il accuse Nike d’avoir mis un coup de pied sous la table et de leur avoir tiré le tapis sous les pieds. Pire encore, ils reprochent à la firme d’Oregon d’avoir commercialisé des tokens non enregistrés comme des titres financiers, sans jamais en informer les acheteurs. L’amalgame est lâche: des simples images pixelisées deviennent, sans crier gare, des produits financiers soumis à une réglementation exigeante. La plainte, riche de plus de 5 millions de dollars de dommages et intérêts, repose sur des violations supposées des lois de protection du consommateur dans quatre États américains (New York, Californie, Floride et Oregon). Elle interroge deux points importants: d’abord, la légalité même du statut des NFTs, encore floue en vertu du droit fédéral américain; ensuite, la responsabilité des grandes marques qui surfent sur la vague cryptographique sans en comprendre ni les enjeux ni les risques pour leurs clients.
Évidemment, Nike n’a pas tardé à botter en touche. Les demandes de commentaire sont restées lettre morte, et Phillip Kim, conseil des plaignants, s’est muré dans le silence. Classique posture des multinationales: le moins que l'on puisse dire, c’est qu’elles n’ont pas l’âme de celles qui reconnaissent leurs errements. Pourtant, la justice pourrait bien leur rappeler que la confiance des consommateurs ne se marchande pas à vil prix. Derrière ce fait divers se profile une critique plus globale, celle du mythe NFT. Présentés comme révolutionnaires, ces jetons non fongibles peinent à démontrer leur utilité réelle. Collectionner une image ou un fichier, sans jamais pouvoir en jouir pleinement, ne convainc que quelques initiés. Quant à l’idée de revendre ces actifs, la plupart du temps, il s’agit d’une loterie spéculative où seuls les premiers entrants tirent leur épingle du jeu.
Le cas Nike/RTFKT sonne le glas d’une illusion, celle selon laquelle la mise en blockchain garantirait la pérennité d’un produit. En réalité, un contrat digital, aussi sophistiqué soit-il, dépend entièrement de l’engagement de celui qui l’émet. Mettez un mastodonte comme Nike dans la balance, et vous comprendrez vite que le mot « engagement » prend tout son sens. L’entreprise peut choisir de partir du jour au lendemain, et vos précieux NFT ne valent plus un kopeck. Le procès fait donc figure de sonnette d’alarme. Il invite à la prudence, à la réflexion, et rappelle que la technologie, sans éthique ni contrôle, peut se retourner contre ses propres instigateurs. Pour les consommateurs, la leçon est claire, avant de se lancer, il faut savoir sur ce que l’on mise, et mesurer la fiabilité de ceux qui vendent ces promesses numériques.
L’affaire est symptomatique d’un appétit vorace pour l’innovation sans véritable vision. Les NFT n’ont ni la robustesse d’un titre financier classique, ni l’usage d’un bien tangible. Ils demeurent un avatar de la spéculation moderne, un miroir aux alouettes pour investisseurs en quête de sensations fortes. Que Nike soit la première grande marque à s’y brûler les ailes n’a rien de rassurant. Nombreux sont ceux qui suivront, pensant qu’ils feront mieux ou autrement.
Source: Reuters